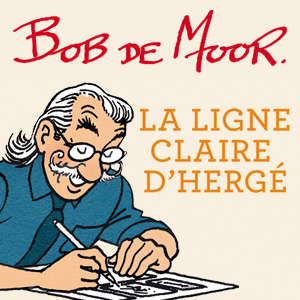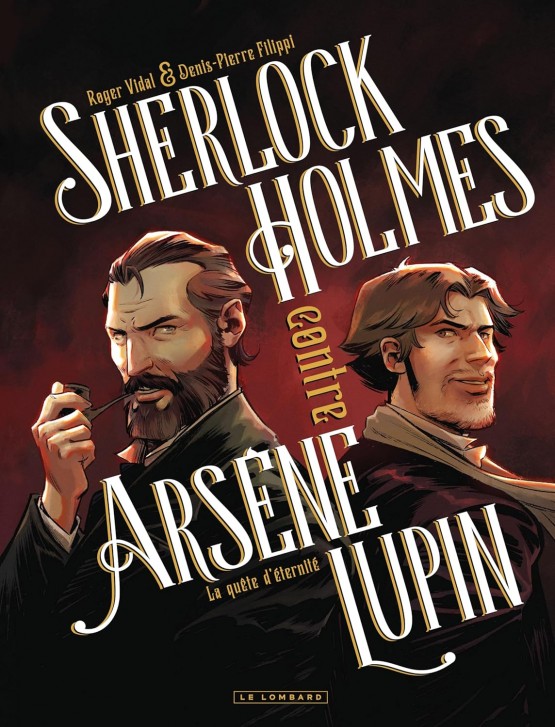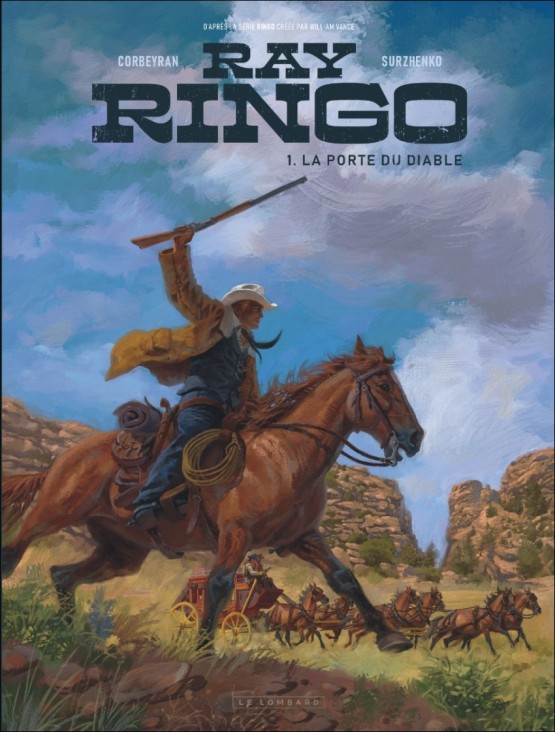Quel plaisir, après des années et des années de chroniques sur les nouvelles parutions concernant le 9e art, de continuer à découvrir des auteurs prometteurs qui, d’emblée, semblent vraiment maîtriser les codes narratifs et graphiques de la bande dessinée ! C’est d’autant plus méritoire quand il s’agit d’un premier album en ce domaine : ce qui est le cas de Pierre Alexandrine avec son « Amourante ». Ce dense ouvrage de 230 pages, édité chez Glénat, nous propose un voyage aussi palpitant qu’amusant à travers les époques et les lieux, en remettant en question notre obsession tout à fait compréhensible de plaire perpétuellement et de ne pas mourir…
Lire la suite...COMIC BOOK HEBDO n°3 (30/11/2007).

Chaque semaine, la sélection de ce qui se fait de mieux en ce moment dans le monde des comics VF en librairie.
Me voilà bien embêté… Chacun des albums chroniqués ici mériterait à lui seul non pas un grand article mais bien un dossier complet rendant compte de l’ampleur du génie déployé à travers ces pages : deux œuvres emblématiques de l’histoire contemporaine du comic book (Sandman de Neil Gaiman et Watchmen d’Alan Moore, déjà de très grands classiques), et une furieuse curiosité intitulée PopBot, signée par l’un des auteurs actuels les plus talentueux : Ashley Wood le dingue. Je me contenterai malgré tout de la taille de cette chronique afin de donner au plus grand nombre l’envie irrépressible de se jeter sur ces ouvrages indispensables dans un temps de lecture raisonnable (oui, je sais… je fais toujours trop long… et alors ?).
-SANDMAN 7 : VIES BRÈVES (Panini Comics, Vertigo Cult).
Impossible de ne pas penser à ça : en un an, Panini a édité trois volumes de Sandman, c’est-à-dire à un rythme de parution multiplié par cinq par rapport à ce qui avait été fait auparavant en presque dix ans d’une aventure éditoriale difficile et chaotique. C’est une excellentissime nouvelle, puisque nous sommes maintenant à peu près assurés de pouvoir lire l’intégrale en VF de ce chef-d’œuvre avant de rejoindre la tombe. Ouf ! On a eu chaud ! Signe des temps ou évolution du lectorat et des éditeurs, cette création dont on fêtera bientôt les 20 ans va enfin trouver une certaine légitimité en France après de nombreuses vies brèves. Il y a quelques mois, Neil Gaiman – son créateur – m’avait confié lors d’une interview qu’il était très surpris de voir à quel point Sandman avait du mal à trouver sa place en France. D’après lui notre beau pays l’accepterait bien plus volontiers en tant qu’écrivain que scénariste de comics… Sentiment personnel ou réalité, on peut se demander si cette œuvre pourtant ô combien littéraire ne souffre pas dans certains cercles intellectuels français d’un manque de considération frôlant la cécité orgueilleuse simplement parce que c’est de la « bédé américaine ». Assurément, ces gens-là n’ont jamais lu une page de Sandman, et ne le liront que contraints et forcés, pétris d’horribles à priori qui les étoufferont dans les flammes de l’enfer… Et pis de toute façon Gaiman il est anglais, pas américain, et quoi qu’on en dise, Sandman est une œuvre dont le caractère intrinsèque puise autant dans les mythologies modernes américaines que les mythes ancestraux de la vieille Europe.
Quoi qu’il en soit, tout le monde ne s’y est pas trompé outre-atlantique puisque cette œuvre créée par Gaiman et conçue graphiquement par Sam Keith est considérée par beaucoup comme étant l’une des plus brillantes bandes dessinées de la fin du 20e siècle. Chez DC Comics, Sandman est à Vertigo ce que Superman fut à Action Comics : une pierre angulaire, un symbole, une identité. Publiée chez DC Vertigo entre 1988 et 1996 grâce à la passion et à l’intelligence de la rédactrice Karen Berger, cette série est plus qu’une série : c’est une œuvre à tiroirs, pleine et infinie, se déployant en elle-même par des ramifications multiples échappant aux repères habituels d’une certaine narration linéaire. Elle a amené un lectorat intellectuel à se pencher plus sérieusement sur les comic books grâce à sa nature profonde et intelligente, sa qualité d’écriture, son sens extrêmement inventif du récit, donnant toutes ses lettres de noblesse au graphic novel. Notons que Sandman a reçu de nombreux Awards, dont certains prix littéraires qui n’avaient auparavant jamais récompensé de bandes dessinées…
Sandman est une œuvre qui ne s’explique pas, qu’il n’y a pas à expliquer : la seule chose à faire est de la lire, car même les réflexions les plus pertinentes ne sauront jamais amener au lecteur toute l’étrangeté du ressenti éprouvé à la lecture de cette bizarrerie sublime. Un jour, Neil Gaiman avait néanmoins tenté de définir en une phrase cette saga de plus de 2000 pages : « Le Seigneur des Rêves découvre que chacun doit changer ou mourir, et prend sa décision. » Vies Brèves est à ce titre un brillant exemple de l’expression de cette idée puisque les décisions de changement y sont particulièrement importantes. Si vous ne connaissez pas encore Sandman, voici un petit cours de rattrapage qui devrait vous permettre de mieux appréhender la chose : Sandman (appelé aussi Dream, Marchand de Sable, ou Morphée) est l’entité qui règne sur le Royaume des Rêves selon les lois éternelles d’un ordre universel. L’ensemble de l’œuvre nous conte différents moments de l’existence de Sandman à travers le temps, et les interactions qui se nouent et se dénouent entre le monde réel et le monde rêvé, entre l’humanité et les forces cachées qui la transpercent. Ce héros qui n’en est pas un, ni bon ni méchant, est là pour maintenir justement l’ordre des choses, et ne peut que nous inspirer de la sympathie par son caractère profond, sa compassion et sa présence mystérieuse, nuancée. Il appartient à la famille des Eternels, intemporelles et omnipotentes entités à côté desquelles nos dieux et croyances ne sont que folklore. Cette famille est constituée de Desire, Despair, Destiny, Delirium, Death, Destruction, et bien sûr Dream. Chacune de ces entités symbolise une notion inhérente à nos existences humaines : ce ne sont pas des personnages, ce sont des concepts incarnés. L’idée de génie de Gaiman est de ne pas avoir figé ces concepts dans leur existence : ils sont eux aussi en proie aux choix à faire pour continuer d’être là, infléchissant ainsi le sens des valeurs qu’ils expriment et symbolisent. Ainsi Gaiman nous fait comprendre que les vérités existentielles avec lesquelles nous respirons ne valent quelque chose que si elles évoluent, au-delà de toute certitude.
Outre l’écriture et le découpage -de très haut niveau- de Neil Gaiman, l’originalité de Sandman réside aussi dans le fait que ses 75 épisodes aient été réalisés par une trentaine de dessinateurs différents, par alternance et retours, crayonnés et encrages, créant une identité visuelle multiple, toujours différente et pourtant étrangement homogène. Les songes sont polymorphes, donc Sandman est visuellement changeant, adéquation parfaite entre l’expression graphique et la nature floue en vases communiquants de notre inconscient libéré dans le rêve. Le présent album, Vies Brèves, va à l’encontre de ce que je viens d’énoncer pourtant justement, signe que Sandman échappe résolument à tout schéma attendu. En effet, Vies Brèves constitue un cycle graphiquement plus monolithique que « d’habitude » puisqu’il est entièrement réalisé par Jill Thompson, une amie et collaboratrice privilégiée de Neil Gaiman. Encrée principalement par Vince Locke mais aussi par Dick Giordano, la dessinatrice sait cependant nuancer son dessin, passant d’un trait simple à des hachures libres, et, comme dans le superbe chapitre 5, revenir au contraste le plus évident entre ombre et lumière (un passage vraiment magnifique). On peut penser que Gaiman ait choisi cette fois un artiste unique afin d’unir dans une même respiration visuelle les différentes existences rencontrées lors de ce périple, toutes liées par la décision de faire un choix pour subsister.
Je ne vous raconterai rien des histoires de Vies Brèves, car il n’y a rien de plus beau que de se plonger dans un album de Sandman en étant dans cet état d’innocence prête à être bouleversée par la beauté et l’intelligence, la folie, la pureté, l’humour et l’accent tragique de l’imaginaire de Gaiman. La seule chose que l’on pourrait dire pour donner une petite idée de ce que contient cet album sans rien en dévoiler d’indélicat, c’est que Delirium (l’une des sœurs de Sandman) demande à sa famille de partir à la recherche de leur frère disparu : Destruction. Destruction est le membre des Éternels qui est peut-être le plus étrange, le plus inconnu, le plus ambigu, le seul à s’être retiré de ses responsabilités (nous voyons ici à quel point ce que je soulignais plus haut sur ces entités incarnant des valeurs non figées par rapport à la conscience collective prend ici tout son sens). Seul Sandman acceptera d’aider Delirium à retrouver ce frère disparu depuis 300 ans.
Ce qui frappe le plus en lisant le titre de Vies Brèves, c’est le miroir qu’il tend vers l’existence infinie des Éternels, nous poussant à relativiser la notion de « temps légitime » d’une vie. C’est là l’une des nombreuses et profondes réflexions qui sont abordées dans ce nouvel opus disséquant avec subtilité les méandres de ce qui nous constitue toutes et tous, de manière consciente ou inconsciente. En lisant ces pages, on ne peut que rester transpercé d’admiration devant tant d’acuité, de culot et de finesse dans les propos exprimés. Et si comme moi vous avez une certaine tendresse pour le personnage de Delirium, vous allez vous régaler, car elle transcende littéralement ce récit par sa présence étonnante, ses réparties dingues et naïves, ses réactions de gamine et ses bulles irisées de couleurs psychédéliques. Bref, je ne trouverai jamais assez d’adjectifs pour encenser Sandman et son créateur, je citerai donc Peter Straub qui finit sa postface dans ce livre par « Si ceci n’en est pas, rien n’est littérature. »
Je ne pourrais décemment pas terminer cet article sur Sandman sans parler du complice de toujours de Gaiman : j’ai nommé le génial Dave McKean. McKean, si enclin depuis toujours à exprimer l’ineffable par son art constitué de différentes techniques ouvrant différentes perceptions, était la personne rêvée pour exprimer toutes les nuances de visions et d’intentions de Gaiman au sein de cette œuvre monumentale. Il a supervisé la maquette de l’ensemble de l’œuvre, ainsi que l’intégralité des couvertures, créant ainsi une continuité et une cohérence esthétiques à cette œuvre aux mille visages picturaux. Son travail exceptionnel offre un somptueux écrin à la série qu’il hante littéralement de son talent exceptionnel, développant ses visions successives de Sandman dans des créations graphiques époustouflantes où peinture, photo, dessin, collage, objets et travail informatique se mélangent dans d’étranges beautés pénétrantes. Ce foisonnement intimiste engendre des richesses visuelles qui marquent profondément notre rétine sensible, réveillant en nous des sensations qui échappent aux mots… Une merveille.
-POPBOT : SECOND LIVRE (Éditions Carabas).
Tenter de parler de PopBot, c’est un peu comme essayer de jouer de la batterie tout nu sur un arc-en-ciel radioactif, de peindre hystériquement la queue d’un tigre en noir pour se faire une paire de moustaches, ou bien de s’immoler avec du sirop de grenadine acheté chez un garagiste pervers. Comment ? Quoi ? Je délire ? Je dis n’importe quoi ? Eh bien vous n’avez pas lu PopBot, alors, car ces menues fantaisies ne sont que du pipi de chat à côté de… ça ! Pipi ? Chat ? Oui, nous sommes encore dans le sujet, je ne m’éloigne pas trop… Car l’histoire de PopBot est finalement très simple, très banale. Premièrement, prenez un chat répondant au doux nom de Kitty (oui oui, c’est un mâle, c’est normal). Ce chat était le chanteur vedette du groupe punk « 2215 Funlicker » (oui oui, un chat qui chante, c’est normal). Deuxièmement, prenez un robot un peu bête mais massif nommé PopBot qui était le roadie du groupe et qui reste le garde du corps de Kitty (bah oui, cette machine de destruction tient beaucoup à son p’tit chat, c’est normal, non ?). Troisièmement, prenez des robots féminins appelés « Mortis », créés pour assouvir tous les désirs sexuels des hommes dans une plastique plus qu’alléchante, et qui maintenant plus n’ont qu’un désir : buter les mecs. Quatrièmement, ajoutez des personnages tels qu’un Sherlock Holmes très ambigu qui regrette les perversions auxquelles il s’adonnait avec ce cher Watson, un diable qui est une… chaussette manipulée en marionnette (!!!), un cow-boy aveugle qui perd ses dents en explorant les sous-sols de la croûte terrestre, des samouraïs appelés Ronins-Elvis, un clone d’Andy Warhol qui présente une émission de télé disons plutôt… spéciale, une superbe et cruelle agent appelée Lady Sham, ou des personnages issues de la série The Maxx (tout ça est plus que normal, je vous dis). Cinquièmement, mélangez le tout dans un sublime foutoir où Kitty – que tout le monde semble rechercher pour lui faire la peau – veut retrouver le créateur de PopBot afin de lui revendre ce dernier et se faire plein de fric. Revendre la seule personne qui veut vous protéger, quel beau projet ! Voilà, c’est fait : vous avez PopBot, une des œuvres les plus dingues que vous pourrez lire dans votre vie, un ovni, une déflagration proche du subconscient qui ne recule devant aucune outrance verbale ou graphique. C’est beau, c’est déjanté, parfois incompréhensible mais toujours passionnant, étonnant d’un bout à l’autre de l’exploration du livre.
Car il s’agit en effet plus d’une exploration que d’une lecture telle qu’on l’entend habituellement, une expérience singulière engendrée par la nature même du travail de Wood. Ashley Wood est – avec Sam Keith – l’un des plus dignes héritiers de « l’école Sienkiewicz », mélangeant les styles et les techniques selon les possibilités du récit, osant les digressions et les exagérations, brouillant les pistes entre réalisme et imaginaire dans des extrêmes pouvant aller de la photo à la caricature, débordant du cadre et sublimant l’esthétique, dynamitant l’attendu pour atteindre des profondeurs humaines sidérantes… Ce n’est donc pas un hasard si Wood le dingue se retrouve avec Keith le cinglé sur ce projet complètement psychotique. Sam Keith – outre la présence de ses personnages de The Maxx dans l’ouvrage – a participé à l’écriture de PopBot sans égratigner l’univers très personnel qu’Ahley Wood déploie ici dans un processus d’éructation de l’intime fantasmé. PopBot n’est pas pour Wood un exutoire ni un défouloir, mais bien un champ créatif aux frontières abolies afin de mieux en creuser les possibilités les plus folles. Le résultat graphique est une incontestable réussite, crevant la rétine de ses beautés fulgurantes et vénéneuses. Vous connaissez tous ce petit geste instinctif qui consiste à ouvrir un album en le feuilletant rapidement pour sentir si l’univers graphique du dessinateur est aussi chouette que la couverture qui nous a fait prendre l’ouvrage en mains, accrochant notre regard sensible avec évidence. Eh bien lorsqu’on feuillette PopBot, la première impression est si radicalement différente de presque tout ce qu’on a l’habitude de voir dans la logique d’un ouvrage à lire qu’on ne peut que rester en arrêt devant chaque page, différente, intrigante, puissante, se demandant où le récit trouve sa place, avec le délicieux sentiment de parcourir un livre d’art reproduisant à chaque page une peinture ou une gravure en relation directe avec les autres. Bien entendu, le récit trouve pleinement sa place, et PopBot est bien une vraie bande dessinée et non pas une succession d’images. Mais ceci est un premier signe inhérent au travail narratif que Wood a étiré, transformé, afin de créer un autre rythme de la description, une autre approche de l’espace scénique, une autre conception de ce que pourrait être la bande dessinée si elle voulait bien se libérer un peu. Chaque case équivaut à peu près à une page, ce qui allonge la lecture dans un épanouissement visuel arrivant néanmoins à ne pas casser le rythme du récit. Pourtant, Wood ne se gêne pas à certains moments pour malmener la notion même de récit ou de narration pour l’entrecouper de séquences improbables ou pour lui tordre le cou sans nous offrir la moindre connivence qui nous permettrait de nous sentir moins perdus : je ne sais pas vous mais personnellement j’adore ça !
C’est visuellement très beau. Un Ashley Wood en très grande forme, inspiré et redoutablement efficace. Les femmes qu’il dessine ont une volupté charnelle frôlant l’insensé, et ses robots sont très réussis. Wood passe avec bonheur de ses fameuses images sépias (où un hyper réalisme photographique semble déformé par un prisme voluptueux) à des dessins très graphiques, très simples, où la couleur est traitée en à-plats, ou bien encore à des peintures expressives à la touche lâchée. Notons aussi un beau travail au niveau des trames mécaniques que Wood utilise à très bon escient. La mosaïque créée par ces différents styles se percutant, se mélangeant ou se suivant, garde une cohérence générale exemplaire. PopBot est un vrai laboratoire qui réussit à ne pas tomber dans le piège de l’alibi expérimental pouvant tuer le propos par la grandiloquence : la folie est polymorphe mais interne et non pas pulvérisée dans tous les champs d’action. En cela PopBot évite bien des écueils que pourtant cette œuvre semble presque provoquer afin de voir si elle saura les résoudre par une fulgurance ou une brèche à creuser méchamment. Un jeu dangereux, tout comme l’histoire qui nous est contée. PopBot a une place très spéciale dans le cœur d’Ashley Wood : c’est une œuvre sur laquelle il revient depuis des années à chaque fois qu’il a besoin de se ressourcer entre deux travaux plus officiels chez les grandes majors, un espace de création totalement libre qu’il creuse de manière brute pour tirer de soi l’indicible à expérimenter, dans un cheminement établi mais constamment réinventé. Un work in progress, donc, avançant à son rythme.
Après avoir beaucoup parlé de la forme, parlons maintenant un peu du fond si vous le voulez bien (et même si vous ne le voulez pas, d’ailleurs). PopBot est de manière générale très casse-gueule, ou pour être plus exact très borderline. C’est brutal, sexuel, ordurier, débile et outrancier. Et pourtant c’est bien autre chose, plus lucide, plus interrogatif. Derrière une apparente complaisance à exulter ce qu’il y a de plus primaire dans le sexe et la violence pour en faire un spectacle gratuit se cache un état des lieux de notre monde moderne, de ses fantasmes et de ses horreurs. Ce monde moderne présentant la vie et la mort comme des produits de consommation, transpercé par de terribles charniers moraux où l’ignoble maquillé est accepté avec une candeur hypocrite. Pour ce faire, le langage qui a cours dans PopBot est clair et sans ambages. Habituez-vous dès lors à lire un mot ordurier ou une injure toutes les cinq syllabes… Je ne résiste d’ailleurs pas au plaisir de vous citer un dialogue très représentatif de ce que vous pourrez lire tout au long de cette création iconoclaste :
« - Où est Kitty, sale fils de pute ?
- Dans ton cul. Je ne sais pas où est Kitty, et ce qu’il fait te regarde pas, face de merde. »
Sympathique, non ? La surenchère de grossièretés qui émaille les dialogues et les textes est si énorme qu’elle atteint souvent des paroxysmes d’absurdité. Entre rire et consternation, la portée de ce langage ordurier devient assourdissante et nous happe dans un engrenage suintant de rancœurs et de menaces. Vous aurez donc compris qu’avec Ashley Wood il faut se méfier des apparences, car là où beaucoup ne verraient qu’une suite de batailles entre des filles à moitié à poil et des robots vulgaires il y a en fait une plongée sans concession dans l’absurdité de notre monde via nos pulsions les plus inavouables.
Un grand merci aux éditions Carabas d’avoir le courage de suivre cette œuvre depuis le début malgré sa nature et son rythme fluctuants, car elles donnent ainsi aux lecteurs francophones l’opportunité de découvrir une œuvre rare et forte qui laisse sur le carreau bon nombre de prétentieux ouvrages. Si comme moi vous aviez acheté le premier volume de PopBot à sa sortie en 2003, nul doute que vous vous jetterez comme des bêtes sauvages sur ce deuxième opus qui – croyez-moi ou pas – est encore plus dingue que le premier (oui, comme vous dites). Un dernier mot : Kitty a de sacrés bons goûts musicaux puisqu’il adore Tom Waits.
-WATCHMEN (Panini Comics, DC Absolute).
Houla, bon, hum… Comment vous écrire quelque chose de concis, de compréhensible et de complet sur un pareil monument en si peu de lignes alors qu’il faudrait l’épaisseur d’une thèse pour en tirer toute la substantifique moelle..? Bon allez je me lance…
Watchmen représente tout simplement avec The Dark Knight Returns et The Sandman le fleuron de ce qui a été un renouveau décisif et historique pour DC Comics à partir du milieu des années 80. Annonciateur de la nouvelle vague anglaise mais aussi synonyme de la reconnaissance d’un très grand scénariste avec qui il faudra désormais compter et qui allait révolutionner l’univers du comic book (Alan Moore), Watchmen a amené une autre manière d’aborder le thème du super-héros. Cette vision aussi lucide que décalée par rapport aux us et coutumes en place allait ouvrir tout un pan de la mythologie connue – que d’aucuns définiraient comme une véritable boîte de Pandore – qui n’avait jamais réellement été exprimée sur un ton aussi adulte. Car après avoir débroussaillé les innombrables pistes de réflexion amorcées dans cette œuvre labyrinthique et complexe, la question qui reste dans les esprits est : les super-héros sont-ils des fachos ? Et s’ils le sont, Who watches the Watchmen ? Plus de 20 ans après ses débuts (c’était exactement en 1986), Watchmen garde toute sa force et reste un chef-d’œuvre absolument incontournable de l’histoire de la bande dessinée contemporaine.
Alan Moore a beau avoir signé par la suite de vraies merveilles (Promethea ou Tom Strong, par exemple), il n’en reste pas moins que l’immensité du talent de Moore éclate dans Watchmen avec une virtuosité donnant le tournis. Chaque planche est une merveille d’art narratif, incluant des niveaux de compréhension alambiqués se rejoignant dans une science admirable. Les différentes strates qui structurent le récit sont ciselées avec un art d’orfèvre, se révélant dans une mise en abîme étourdissante. Car Moore mélange réalité et fiction en brouillant les pistes, ce qui donne une lecture où nous-mêmes faisons partie de cette mise en abîme : nous lisons un album parlant de super-héros vivant dans une réalité parallèle et qui sont devenus des justiciers masqués après avoir lu des comics de l’Âge d’Or de notre monde réel. Au sein même du récit, revenant de manière lancinante, comme un leitmotiv nous piégeant dans ses mâchoires innocentes, un jeune noir lit un comic de pirates réalisé par… Joe Orlando (qui en plus d’être un artiste mythique a été pendant des années vice-président de DC). Le récit qu’il lit vient parfois se mélanger aux cases de ce que nous sommes en train de lire, jusqu’à tisser des liens de causes à effets sémantiques entre les deux œuvres… Sacré Alan Moore ! Il pousse même le vice jusqu’à revenir sur l’histoire réelle du comic book dans les appendices écrits qui clôturent chacune des douze parties constituant l’ensemble afin d’expliquer par rebond certains faits abordés dans le chapitre écoulé. Non, il n’y a pas que de la bande dessinée dans Watchmen, il y a aussi de l’écriture, érudite, malicieuse, terriblement maline puisqu’elle complète l’intrigue tout en la dévoilant sous un jour nouveau où nos synapses sont très sollicitées. Le tout est ainsi construit que cette lecture qui s’étend sur 400 pages devient une véritable aventure en soi, qu’on n’oublie pas de sitôt, transportée par une esthétique très plaisante. Dave Gibbons a en effet réussi avec beaucoup de talent à dessiner une histoire compliquée à mettre en images. Son trait souple, élégant et très sûr, confère à cette création unique une identité tout à fait réaliste et néanmoins prête à déraper.
L’histoire, en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce monument : les Gardiens (Watchmen) se souviennent des grandes heures des Minute Men, de leurs aïeuls, de leurs exploits passés. Aujourd’hui, considérés comme trop dangereux, les super-héros ont été mis hors de circulation par les autorités et doivent avoir rejoint les rangs de simples citoyens. Mais le Comédien, le membre des Watchmen le plus réactionnaire et le plus violent, a été assassiné. Hasard, complot ? C’est ce qu’essaye de savoir Rorschach, le membre des Watchmen le plus psychotique, tenant son nom du test homonyme et dont le masque qui lui couvre le visage reprend les fameuses taches en miroir dans une succession ininterrompue de motifs différents (pour ma part l’invention la plus remarquable de Moore dans cette série). Il ne reste que 12 minutes avant la catastrophe inéluctable. Les autres Watchmen vont-ils soutenir Rorschach dans son enquête ? C’est ce que vous saurez en lisant cette merveille.
La présente édition, sous coffret, propose en plus de l’intégralité des épisodes une soixantaine de pages de bonus contenant des textes de Moore inédits en France ainsi que de nombreux croquis et recherches de personnages ou de couvertures réalisés par Dave Gibbons. Malheureusement un peu chère, cette édition intégrale de Watchmen se doit de figurer en bonne place dans les rayons de votre bibliothèque si vous ne possédiez pas encore cette œuvre.
That’s all, Folks !
Cecil McKinley.