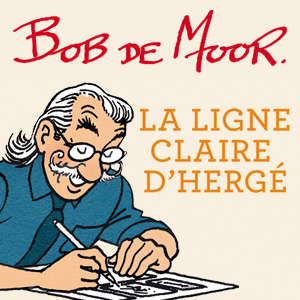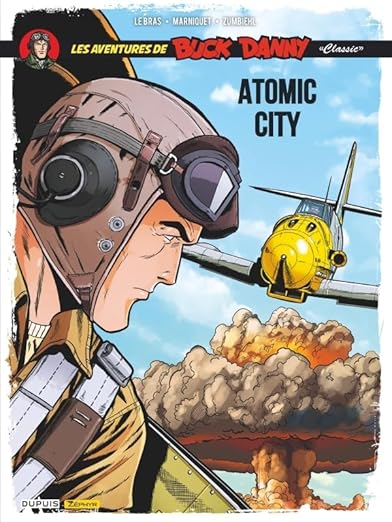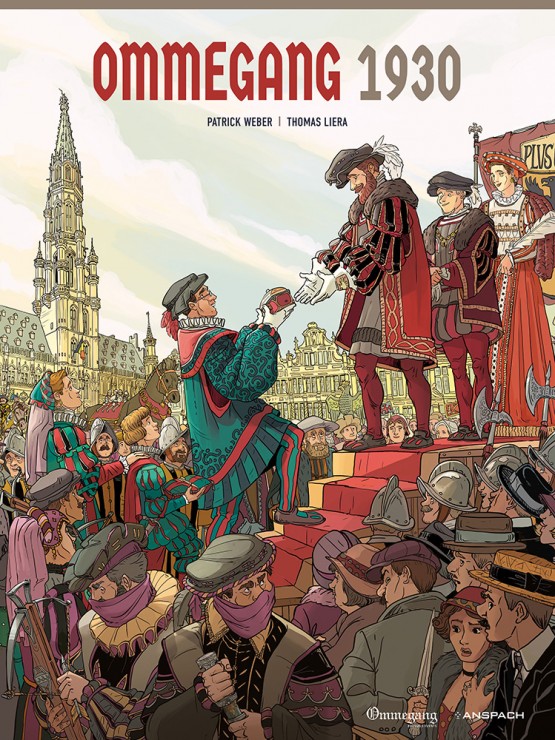Les catacombes de Paris sont depuis longtemps un lieu de fantasmes et de rêveries. Ses galeries creusées dans d’anciennes carrières souterraines s’étendent sur des centaines de kilomètres, 20 mètres sous terre. Et si sous ce premier degré existaient d’autres niveaux, jusqu’à un septième peuplé par une communauté souterraine isolée de ceux de la surface. C’est ici que grandit Tia : une préadolescente aventureuse qui veut découvrir ce qu’il se passe dans les rues de la capitale.
Lire la suite...SUPER-HEROS DE PRINTEMPS 2007 (1/2).

La sélection mensuelle de ce qui se fait de mieux dans le monde des comics en parution française : les news, les sorties d’albums chroniquées et les parutions en kiosque.
NEWS
Bonjour chères et chers passionné(e)s de comics en tous genres… Comme je vous l’ai annoncé récemment sur ce site, cette chronique mensuelle est un peu (!) mise à mal en ce printemps ébouriffant à cause de restructurations dans la communication de certains éditeurs, ce qui occasionne des retards et quelques aléas bien indépendants de ma volonté, croyez-le bien… Mais d’ici peu tout rentrera dans l’ordre, c’est promis juré craché (j’espère de tout cœur que les choses vont se recaler d’ici l’été). Je tiens à m’excuser personnellement auprès d’Emmanuelle Klein, chez Delcourt, qui a dû me maudire pendant ces deux mois où je n’ai pas eu l’occasion d’écrire sur l’album qu’elle m’avait fait parvenir en temps et en heure…
Le côté positif de la chose (il y en a toujours un), c’est que ce retard conséquent me permet de remettre en avant des ouvrages qui méritent qu’on continue de parler d’eux au-delà du bouillonnement médiatique éclair auquel ils ont droit à leur sortie, les livres ayant à notre époque une visibilité réductrice et pour la plupart une durée de vie bien trop restreinte.
Je traiterai donc les sorties de ce printemps 2007 en deux chroniques ; la seconde viendra dès que possible, je vous le promets. Et puisque vous ne m’avez pas lu pendant près de deux mois, je vous conseille de vous installer tranquillement avec un bon petit verre à la main, car la présente chronique prend le temps de parler des choses, avec des mots tout plein partout partout. Mais après tout, vous êtes libres de ne vous pencher que sur les titres qui vous intéressent, je ne vous en voudrai pas le moins du monde (grrrr…).
Les incontournables en librairie: Spawn vol.2, Promethea vol.4, Desolation Jones vol.1, The New Avengers vol.1.
Les incontournables en kiosque: Les Chroniques de Spawn, Civil War, Ultimate Fantastic Four.
EN LIBRAIRIE DEPUIS MARS
-SPAWN vol.2 : MALEDICTION (Delcourt, collection Contrebande).
Les éditions Delcourt continuent leur travail de réédition de certaines des œuvres phares américaines des années 90 : bravo ! Car cette décennie a profondément changé l’univers des comics, renouvelant le paysage éditorial de manière si significative qu’on en voit encore aujourd’hui les conséquences dans nombre de publications. Parmi les fers de lance les plus emblématiques de cette période, il faut bien sûr tenir compte du Spawn de Todd McFarlane, une série made in Image qui a plongé les comics dans un contexte de noirceur et de grand guignol profondément marquant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette œuvre (oui, il y en a), rappelons le postulat de base : Al Simmons, un ancien agent des Forces Spéciales américaines, a été assassiné par ses supérieurs. Il se retrouve en Enfer, et pactise avec les puissances maléfiques afin de pouvoir revoir sa femme. Sous la forme d’un Hellspawn (une créature chargée de mener les hordes infernales à la victoire sur le monde), il hante les bas-fonds de New York, à la recherche d’un sens à cette nouvelle existence qu’il apprend à connaître malgré lui, combattant de nombreux ennemis (pas toujours ceux auxquels on pourrait penser).
Après un premier tome paru en mai 2006 (Résurrection) qui reprenait les tout premiers épisodes de la saga, voici donc Malédiction, un deuxième beau volume de plus de 300 pages qui permettra à tous les fans et les passionnés de cette œuvre de continuer à dévorer la suite de Spawn (épisodes 14 à 25) dans une présentation remarquable, reprenant les illustrations de couvertures originales. Sans vous dévoiler le contenu de ce volume qui réserve bien des surprises et des émotions fortes, je peux tout de même vous en dire quelques mots, lecteurs infernaux ! Les présents épisodes sont traversés par la trame d’un complet complot complexe contre le meilleur ami de Simmons, celui-là même qui vit désormais avec Wanda, son épouse tant aimée. C’est donc les proches de Spawn qui sont ici en grand danger, et celui-ci mettra tout en œuvre pour tenter de les sauver d’un péril organisé par de sombres autorités. La tâche sera plus qu’ardue, car Spawn va se retrouver coincé entre plusieurs feux maléfiques à souhait. Ta-daaaa.. ! Va-t-il réussir ? On retrouvera avec grand plaisir au détour de ces aventures les deux flics atypiques Sam et Twitch qui – depuis ces faits – ont accédé à une notoriété telle qu’ils ont maintenant leurs propres titres, souvent signés par des pointures (Delcourt publie d’ailleurs l’une d’elles, Les Enquêtes de Sam & Twitch). On rencontrera aussi des personnages plus inattendus, comme le magicien Houdini, pour une aventure très décapante.
Car au-delà des combats entre l’Enfer et notre monde, McFarlane entretient et revisite les mythes et les croyances de nos sociétés modernes pour mieux mettre le doigt là où ça fait mal : dangers nucléaires, drogue, violence, meurtres organisés, déchéances urbaines, conditions de vie déplorables, misère humaine. Oui, au-delà des apparences d’un comic de fantastique, Spawn constitue l’une des œuvres graphiques les plus dérangeantes pour notre quotidien établi dans la violence et la corruption. Spawn dérange car il dénonce sans état d’âme ce qu’il y a de pire en nous, et il dérange d’autant plus qu’il le fait dans un esprit flamboyant, ironique, désespéré, exacerbé, sans concessions, où horreur et humour s’entrelacent étrangement. Un drôle de mélange qui laisse une drôle d’impression, celle d’un constat sans appel sur une humanité pétrie de contradictions cruelles.
On ne peut encore une fois qu’être admiratif du travail de McFarlane en parcourant ces pages. Certes, il y a le fond, et là McFarlane s’en donne à cœur joie en mélangeant les genres les plus improbables, nous offrant des histoires le plus souvent complètement dingues. Mais il y a aussi le découpage, très dynamique, plein d’invention, nous surprenant par des audaces narratives et graphiques se rejoignant dans une osmose parfaite et redoutablement efficace. Parlons enfin des dessins et des couleurs. Là aussi cette œuvre ne cesse de surprendre par ses exacerbations esthétiques, à la fois grotesques et raffinées, subtiles et exagérées, où l’outrance est distillée avec une volonté toute particulière.
Dernier point, et non des moindres, notons la participation du remarquable scénariste Grant Morrison ainsi que celle du dessinateur Marc Silvestri, et l’arrivée de Greg Capullo au crayon, celui-là même qui reprendra le flambeau de McFarlane sur la série.
Pour ceux qui auraient loupé le premier tome d’ores et déjà épuisé, soyez rassurés : Delcourt l’a réédité.
Incontournable, avez-vous dit ? Par l’Enfer, vous avez raison !
-PROMETHEA #4 (Panini Comics, 100% ABC).
ATTENTION CHEF-D’ŒUVRE ! Promethea est sans nul doute l’une des plus belles œuvres du grand Alan Moore. C’est un bijou, une merveille, une rareté, une curiosité. Une vraie et grande et magnifique et incomparable création. Une des bandes dessinées les plus inventives et les plus intelligentes qui ait jamais été créée. J’exagère ? Point du tout. Promethea est tout simplement une œuvre UNIQUE. Par le sujet, par le ton, et surtout par un découpage qui renvoie bon nombre de créations modernes au rang de platitudes ineptes. Il y a plus d’invention et de folie dans une page de Promethea que dans n’importe quelle autre BD. Ceux qui connaissent cette œuvre me comprendront. Ceux qui ne la connaissent pas devraient se dépêcher de dénicher chez leur libraire favori les trois premiers tomes parus précédemment chez Semic avant d’entamer ce quatrième opus (merci Panini de reprendre cette série qu’il aurait été criminel de laisser en suspend). Et même si vous ne trouvez pas ces trois premiers tomes et que vous risquez de ne rien y comprendre en prenant le train en marche, jetez-vous comme des bêtes fauves sur le présent volume, quitte à bousculer sauvagement celui ou celle qui aurait le toupet de prendre le dernier exemplaire devant vous (hum… là je crois que la passion me monte un peu à la tête, non ?). Vous l’aurez compris, pas question de passer à côté de Promethea.
Avant de continuer sur ma lancée dithyrambique, je vais marquer une pause pour essayer de définir cette œuvre indéfinissable. Très très peu de bandes dessinées ont su ou osé s’attaquer au thème de la création pure (on retiendra tout de même le génial Cages de Dave McKean, publié en France aux éditions Delcourt), et pratiquement aucune n’a fait de l’IMAGINATION le personnage principal d’une BD. L’histoire de Promethea remonte au Ve siècle, à Alexandrie, où la jeune fille d’un mage assassiné devient l’incarnation de la création en passant du monde tangible à celui d’Immateria, le monde de l’imaginaire. Cette femme-symbole (oui, c’est bien elle, Promethea) traverse les siècles et les arts par le biais de créateurs et de créatrices qui se sont penchés sur cette entité dans leurs œuvres, jusqu’à devenir eux ou elles-mêmes l’incarnation de celle-ci dans notre univers visible. Car dans Promethea l’imaginaire n’est pas un monde inventé, c’est un monde tout aussi réel que notre réalité palpable, mais qui existe sur un autre niveau de conscience. L’œuvre de Moore se consacre à la dernière incarnation en date de Promethea, Sophie Bangs, une étudiante ayant des aspirations littéraires, dans une fin de XXe siècle réinventée avec tout le talent et la lucidité qu’on connaît au lion anglais.
Comme dans la plupart de ses œuvres, Alan Moore entretient avec malice et acuité le premier et le second degré (voire un peu plus) afin de mieux cerner son propos en refusant de l’aplanir à un seul niveau de lecture, un seul niveau de compréhension. Il mélange au sein de sa narration les repères de notre réalité et de notre imaginaire pour les mettre en abîme avec une vision du monde où cette réalité et cet imaginaire sont redéfinis selon de nombreux et subtils renvois et de trompeuses digressions. Si bien que ces deux paramètres nous semblent proches tout autant que fantasmés, et que notre position de lecteur ancré dans le réel et se plongeant dans une œuvre de fiction s’en retrouve chamboulée (principe qu’il utilisa dans les Watchmen où ses héros de papier étaient pétris de comics bien réels, comme Superman ; en ce sens, Promethea est une sorte de nouvelle exploration de cette mise en abîme). Ainsi, dans la réalité réinventée de Moore, existe une équipe de « super-héros » assez pitoyable et répondant au nom ridicule des « 5 formidables » (suivez mon regard). Mais si les clins d’œil parsèment avec bonheur Promethea, il ne faut pas oublier pour autant d’autres hommages appuyés donnant lieu à diverses réflexions sur la création d’œuvres graphiques et littéraires chères à Moore et fondatrices de toute une culture souvent mésestimée et pourtant importante. En effet, à travers les pérégrinations de Sophie et de Promethea, nous abordons aussi toutes les facettes de notre culture populaire (pulps, comics, romans fantastiques) en lien direct avec d’autres œuvres plus anciennes et considérées comme classiques. Moore jette des ponts entre elles, les restructure, les tord pour mieux les disséquer et en tirer une philosophie de complémentarité où il refuse avec raison les « grandes » et « petites » œuvres, ne considérant le problème que par leurs qualités intrinsèques. Le miracle est qu’au-delà d’un certain mélange improbable des repères et des valeurs, les choses s’emboîtent et se répondent dans un univers d’une cohérence incroyable et porteur de réflexions qu’on aimerait rencontrer plus souvent dans les comics. L’humour y est toujours présent, souvent mordant, toujours salvateur, au sein d’une narration pleine et profonde, remplie de gravité : l’équilibre se crée. C’est là tout le génie de Moore. Tout ? Non, il y autre chose…
Cette autre chose, je l’ai déjà esquissée plus haut, est un découpage tout simplement fabuleux. Un découpage si inventif et libre tout autant que génialement maîtrisé qu’on a l’impression de redécouvrir la bande dessinée (beaucoup de nos « stars » de la BD actuelle devraient en prendre de la graine, au lieu d’enfiler case sur case sans comprendre ni savoir articuler les méandres de la narration). En effet, ce découpage est si fort, si original qu’il en devient presque un personnage à part entière de cette création merveilleuse. Pas une planche, pas une case n’échappe à la créativité débridée de Moore. Notre manière même de lire une bande dessinée est remise en question, chaque épisode étant régi par des codes graphiques particuliers qui font écho à chaque planche passée, à chaque planche future, dans une prolongation évolutive et redoutablement ciselée. Ainsi, ce ne sont plus les cases qui structurent la logique de la narration mais les éléments du dessin qui constituent les cases, ou bien un décorum thématique et décliné qui construit l’unité de la planche. Ou bien encore, le sens de lecture se plie à la nature du mouvement graphique, allant de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas ou de bas en haut, ou tournoyant selon une adéquation du fond et de la forme. La planche, souvent double, redéfinit l’espace et le temps avec ingéniosité en se fragmentant par l’esthétique. C’est génial.
J’ai déjà été beaucoup trop long, mais ON NE PEUT passer sous silence l’homme qui dessine, ainsi que celui qui encre, ainsi que celui qui met en couleurs. Car au-delà du talent fou d’Alan Moore, Promethea est aussi un bijou de beauté graphique. J.H. Williams III, le dessinateur, excelle comme il a rarement excellé. Son trait est de toute beauté, et lui aussi semble se remettre en question à chaque planche. Selon l’épisode et l’univers évoqué, son style se métamorphose et passe de la finesse absolue à l’épaisseur assumée, mélangeant les styles à l’intérieur d’une même image selon la nature du personnage traité, se risque au mélange informatique, se veut essentiellement graphique dans des bichromies au contraste époustouflant, ou bien se dirige vers la peinture, gardant une homogénéité toute en nuances (tout ceci est particulièrement vrai pour ce quatrième tome). Mick Gray, l’encreur, transfigure carrément le trait de Williams III. En véritable enlumineur, il apporte à la liberté de trait de ce grand dessinateur une finesse et une précision remarquables, travaillant les contrastes du noir et du blanc avec un réel talent, offrant à notre regard une puissance graphique pleine de subtilité. Le tout est divinement mis en couleurs par un Jeromy Cox particulièrement inspiré. Ses couleurs sont de toute beauté. Rarement quatuor aura été si complémentaire.
Et puis, pour finir (après je vous laisse tranquille), un détail majeur : qu’est-ce qu’elle est belle, Promethea !!!!!!!!
Si vous ne lisez pas Promethea, j’vous cause plus, na !
-SPIDER-MAN : L’INTEGRALE 1974 (Panini Comics).
Ce nouveau et douzième volume de l’intégrale des aventures du Tisseur de toile est important à plusieurs titres :
1°) 1974 est l’année où Stan Lee se retire complètement de la série, que ce soit en tant que rédacteur ou scénariste. Un véritable tournant pour ce titre mythique ! C’est l’illustre Roy Thomas qui mène la barque en devenant le rédacteur d’Amazing Spider-Man, faisant entrer de plain-pied notre beautiful looser dans le cœur des seventies. Au scénario, nous retrouvons le jeune et talentueux Gerry Conway (il avait seulement 19 ans lorsqu’il commença à écrire pour cette série en 1972 !). Conway a été un scénariste clé d’Amazing Spider-Man, puisque c’est lui qui traumatisa non seulement Peter Parker mais aussi toute une génération de fans en écrivant le fameux épisode de la mort de Gwen Stacy. Il est aussi le créateur du Punisher qui fait sa première apparition dans le présent volume, rien que ça ! Côté dessin, c’est Ross Andru qui officie, remplacé sur un épisode par John Romita Sr.
2°) 1974 est aussi l’année de création de deux titres éphémères qui – dans le principe – allaient faire des émules par la suite (Marvel Two-in-One dans les seventies, par exemple). J’ai nommé Giant-Size Super-Heroes, qui n’eut droit en tout et pour tout qu’à un numéro, et Giant-Size Spider-Man, un trimestriel qui dura le temps de six numéros. Dans le seul et unique Giant-Size Super-Heroes, nous retrouvons Spider-Man dans une aventure qui fleure bon le film d’horreur puisqu’il y combat un loup-garou et un vampire (Man-Wolf et Morbius), le tout sous le trait du grandiose Gil Kane (un peu fatigué dans cet épisode, avouons-le).
Le principe des Giants-Size était de proposer une aventure plus longue qu’à l’accoutumée, avec la rencontre de deux super-héros combattant ensemble. En 1974, Spider-Man rencontra dans ce titre Dracula puis Shang-Shi (rien de moins que le fils de Fu Manchu) : l’occasion fut donc donnée de mélanger de grandes figures du fantastique et de l’horreur, pour des histoires quelque peu décalées. Un vrai régal pour les amateurs.
3°) 1974 est enfin l’année de plusieurs faits marquants dans la mythologie de Spider-Man : le mariage annoncé de Docteur Octopus avec Tante May (!?!), le retour du Bouffon Vert, et l’apparition de deux personnages qui feront carrière : le Punisher (mais je l’ai déjà dit) et la Tarentule.
Un album que les fans se doivent donc de posséder, malgré un défaut énorme. Cela ne m’enchante pas de reparler de ça (je l’avais déjà fait pour l’intégrale des X-Men), mais vraiment, je ne peux décemment pas passer sous silence la traduction, la grammaire et l’orthographe de cet album qui sont pour tout dire déplorables. Presque à gâcher le plaisir de la lecture. Sans m’appesantir, il y a l’emploi constant de cette espèce d’argot daté et très connoté parigot qui rappelle les vieux films français (« la maison parapluie » pour parler des flics, « lulure » pour « belle lurette »), une méconnaissance du subjonctif, et de nombreuses erreurs (« après que tu te m’aurais fait ma fête », « reines » au lieu de « rênes », « il est bout bizarre » au lieu de « tout bizarre», « s’immiscer de » au lieu de « s’immiscer dans », « s’aveces un problème » au lieu de « s’avérer un problème », ainsi qu’un même texte dans deux bulles différentes. Par charité je m’arrêterai là, mais vraiment, vraiment, vraiment… Par pitié, faites un effort ! C’est avec un travail comme ça que la bande dessinée a trop souvent gagné ses galons injustes de sous-littérature. Bof !
-DESOLATION JONES vol.1 (Panini Comics, collection 100% Wildstorm).
Voilà un comic atypique et remarquable signé par deux auteurs de talents : Warren Ellis et J.H. Williams III. Desolation Jones est une œuvre sombre, violente, crue, désespérée, naviguant entre polar, anticipation et espionnage. Je me garderais bien de vous en dévoiler la teneur tant la première lecture de cet album laisse un goût amer et vénéneux, distillant des émotions qu’on n’oublie pas de sitôt pour peu que la découverte reste intacte. Cette première saga intitulée Made in England nous permet d’ailleurs d’appréhender le personnage principal et le contexte de la série sans trop en dire, afin d’embarquer le lecteur dans un univers qu’il devra peu à peu reconstituer par retours et sous-entendus.
Un mot tout de même sur la nature de cette curiosité : Michael Jones est un ancien agent du MI6, seul rescapé parmi les cobayes utilisés par le gouvernement britannique dans le cadre du Desolation Test, une expérience confinant à l’ultime cruauté puisqu’elle consiste – au moyen de perfusions – à maintenir un être humain éveillé pendant une année en l’abreuvant constamment de données et d’images horribles. Devenu détective privé à Los Angeles au sein d’une communauté d’anciens espions, Jones doit maintenant apprendre à supporter son corps et son esprit ravagés par le Test, à essayer de vivre après ce cataclysme métabolique tout en résolvant de sombres affaires où le visage de l’humanité apparaît dans toute sa noirceur. Avec malgré tout çà et là quelques jolies fleurs, et un semblant de lumière. Mais aucun espoir. Affublé d’un par-dessus orange et de lunettes d’aviateur d’un autre temps, cet homme à la peau grisée et au corps atrocement abîmé semble tout à la fois impitoyable et rempli de compassion ; une attitude en miroir à ce qu’il a dû surmonter de par le passé. En cela, et malgré un contexte violent où la décadence de l’humanité est décortiquée et exhibée à chaque coin de case, Desolation Jones est une œuvre où la bonté et l’amour – en tant que valeurs en totale perdition – nous sautent à la gorge avec un relief tout particulier. Les moments où Emily Crowe (une ex de la CIA qui a subi une expérience la condamnant à ne plus avoir aucun rapport humain possible) apparaît, une grande émotion nous submerge car sa beauté n’a d’égale que son insupportable solitude. Mais j’avais dit que je ne vous dirai rien et je commence à tout déballer, comme ça, aussi sec…
Desolation Jones a l’apanage des grandes œuvres désespérées qui passent pour un monceau d’horreurs alors qu’elles sont les plus essentielles lorsqu’il est question de parler de la valeur de la vie, de la nécessité de l’amour. Ici, le contraste est si saisissant entre ces deux paramètres que la lecture de cette série est proprement bouleversante. C’est rude. C’est beau. C’est horrible. C’est touchant. C’est assez perturbant, en fait. Mais c’est une lecture nécessaire. D’aucuns trouveront tout ça assez malsain. Il y a du sang. Il y a du sexe. Il y a de la drogue. Il y a du mensonge et de l’atroce. Je leur répondrai simplement. Il y a nos frères humains. Warren Ellis entreprend ici une radiographie de nos valeurs modernes qui ne sont au final que des valeurs archaïques boostées par la technologie. Bref, un regard lucide sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, ce que nous construisons et subissons chaque jour. Une lecture qui nous pousse à nous révolter contre la barbarie banalisée qui nous entoure.
Après le fond, voici la forme. Le découpage d’Ellis est en tous points remarquable, façonnant le rythme et l’atmosphère par des trouvailles percutantes, des enchaînements qui font mouche et des interactions prégnantes. Sa narration nous hypnotise, et l’on a bien du mal à lâcher le livre avant d’être allé jusqu’au bout, et même au bout, la force de son récit allié à la beauté sans faille des dessins très inspirés de Williams III continue de nous hanter pendant longtemps. Car bien évidemment il faut parler du dessin. L’osmose entre le scénariste et l’artiste est telle qu’on a bien du mal à imaginer un autre dessinateur sur ce titre. Son trait à la fois précis et sauvage colle à la perfection aux sentiments véhiculés par Ellis, et sa capacité à passer d’une technique à une autre permet des fulgurances et des contrastes d’ambiances mémorables. On ressent vraiment la désespérance et la complexité du propos dans son trait incisif. Sa maîtrise graphique est indéniablement une très grande réussite et compte pour beaucoup dans l’extrême qualité de cette création, ainsi que les couleurs de José Villarrubia, dont il n’y a rien d’autre à dire qu’elles sont parfaitement exécutées, exprimant avec beaucoup d’acuité les moments forts comme les instants d’accablement, dans une subtilité et une évidence chromatique exceptionnelles.
Bon bah si avec tout ça vous n’êtes toujours pas convaincus, je change de métier, moi.
Suggested for mature readers.
-THE NEW AVENGERS vol.1 (Panini Comics, Marvel Deluxe).
J’avoue qu’au milieu de toutes les nouvelles séries lancées sur le marché du comic-book (souvent intéressantes mais toutes annoncées avec un même ton spectaculaire qui n’aide pas forcément à faire la part des choses), The New Avengers tire son épingle du jeu avec maestria et s’impose comme l’un des titres les plus excitants du moment. Le mérite en revient au décidément très talentueux Brian Michael Bendis qui semble transformer tout ce qu’il touche en pierre précieuse. Ce qu’il y a de remarquable chez Bendis, c’est que cet homme sait de quoi il parle. Là où beaucoup se contentent d’appliquer des recettes de renouveau sur des titres confirmés sans en maîtriser la substantifique moelle, Bendis, lui, connaît sur le bout des doigts les tenants et aboutissants des séries sur lesquelles il travaille, de l’esprit général en passant par les spécificités les moins évidentes, ainsi que ce qu’ont amené les différents auteurs ayant œuvré avant lui sur la vie des personnages. Que l’on se rappelle le travail exceptionnel qu’il a fourni pour Daredevil, où la totale remise en question de l’univers instauré depuis des décennies n’était pas une destruction stérile mais bien un approfondissement de thèmes déjà abordés sans avoir été développés jusqu’au bout de leur logique afin de laisser des portes de sortie. Bendis, lui, ne cède jamais à la facilité de ces pseudo révolutions qui finalement s’avèrent être des coups de théâtre institutionnalisés, des numéros de trapèze avec harnais et filet. Par sa grande connaissance des comics, il ose aller beaucoup plus loin que tout le monde en poussant le bouchon jusqu’aux derniers retranchements de la série, comme si cette prise de risque ultime était le seul moyen acceptable pour lui de s’emparer d’un titre de manière intéressante, le seul moyen de le faire évoluer réellement, en refondant sa mythologie pour mieux la respecter. Il méprise les portes de sortie, et d’ailleurs n’en a pas besoin puisque son talent lui permet de créer des couloirs. Cette prise de position pourrait s’avérer dangereuse si elle n’était qu’un procédé ; mais elle est bien plus que ça : c’est un vrai acte créatif, libre et audacieux, assumé en connaissance de cause, qui fait avancer la série traitée sur des chemins puissants et inattendus. D’où un sentiment d’excitation extrême lors de la lecture d’une œuvre de ce vrai casse-cou du comic-book.
Eh bien tout ce que je viens de vous dire éclate avec superbe dans The New Avengers. Encore une fois, Bendis s’empare d’un mythe avec une audace folle, semble tout démantibuler et pousser la série jusqu’à l’implosion totale, comme si chaque épisode était le dernier. Et pourtant, au-delà de toute espérance, c’est une nouvelle et incroyable ouverture qu’il instaure au sein du titre, une ouverture d’autant plus efficace qu’elle découle de cette impasse annoncée. Et ici quelle impasse ! La fin des Avengers « classiques » servant de charnière aux Nouveaux Vengeurs se termine dans une apothéose cataclysmique rarement atteinte dans le monde des comics. Merci à Panini d’avoir eu le bon sens de nous offrir dans ce premier volume de la série les quatre derniers épisodes d’Avengers (Avengers Disassembled #500 à #504), le numéro ultime Avengers Finale, et bien sûr les 6 premiers épisodes de New Avengers ; bref, un album parfait pour entrer pleinement dans l’aventure. Notons qu’Avengers Finale est l’occasion pour Bendis d’offrir un numéro flamboyant où plusieurs grands artistes se relaient de pages en pages, histoire de finir en beauté : nous retrouvons le dessinateur officiel de la série (David Finch), mais aussi son complice et génial Alex Maleev, ainsi que David Mack et George Pérez pour ne citer qu’eux. Autres bonnes surprises de cet album luxueux, les couvertures originales et leurs « variant », une interview de Bendis, des commentaires de David Finch sur ses passages favoris, des extraits de découpage et de scripts, ainsi que trois pages d’anthologie où sont reproduites les couvertures des 500 premiers numéros d’Avengers. Les dessins de Finch sont très beaux, l’encrage de Miki impeccable, les couleurs de D’Armata sensationnelles.
Sans du tout vous dévoiler l’histoire, revenons quand même sur le choix de Bendis pour constituer la nouvelle équipe, choix judicieux, audacieux, inventif, respectueux et étonnant. Je ne m’attarderai que sur quelques membres, comme par exemple Wolverine qu’il est quand même difficile d’imaginer autrement qu’au sein des X-Men ou en solitaire, un pari risqué mais plein de charme, surtout lorsqu’on pense aux étincelles qui pourraient se produire face à l’autorité d’un nouveau chef, chef qui est ni plus ni moins que le symbole de l’Amérique (gageons que Captain America va avoir une rude tâche avec ce Canadien explosif à ses côtés, non?). Autre gageure, autre audace : faire entrer Spider-Man dans une équipe. Là aussi, Bendis s’offre un petit plaisir bien courageux. Et comme si ça ne suffisait pas, il met côte à côte Spider-Man et Spider-Woman, ce qui est avouons-le un drôle de challenge, risquant la redondance symbolique et le danger d’une originalité fourvoyée. Mais il semblerait que Bendis veuille prendre tous les dangers, que rien ne lui fait peur, ou bien que cette peur le pousse à aller toujours plus loin dans l’extrapolation possible. D’ailleurs, vous verrez que ce « problème » est exorcisé dès le départ, devant les lecteurs et avec humour ; exit le problème, ne reste que le plaisir (je ne parle pas du plaisir d’admirer sans fin la beauté extraordinaire de cette super-héroïne longtemps mise de côté et injustement mésestimée, qui revient depuis quelque temps sur le devant de la scène et c’est tant mieux c’est un de mes fantasmes le crayon de Finch l’a bien compris).
J’A-DO-RE cette nouvelle série.
-TEEN TITANS vol.2 (Panini Comics, Archives DC).
Panini continue d’éditer l’intégrale des New Teen Titans et c’est une idée judicieuse. En effet, contre toute attente, cette équipe à laquelle peu de monde croyait fut à l’origine de l’un des succès les plus retentissants de DC au début des années 80. Après un premier volume paru en 2006 et qui couvrait les débuts de la série en 1980-81, voici donc le deuxième opus nous présentant dans une belle présentation les aventures de nos jeunes surdoués de juillet 81 à février 82, avec en plus de la série régulière un numéro de Best of DC qui leur est consacré avec Carmine Infantino au crayon. Pour la série régulière, c’est évidemment le grand Marv Wolfman qui signe les histoires, et le grand George Pérez qui dessine. Il va sans dire que c’est grâce à ces deux pointures que la série a eu autant de succès, car peu d’artistes auraient pu articuler et mener à la gloire un concept finalement peu évident et déjà amorcé sans succès à la fin des années 60 (d’où le « New » Teen Titans).
Robin, Wonder Girl, Kid Flash, Starfire, Changelin, Cyborg et Raven sont les membres de cette super-équipe destinée à rendre un peu de brio aux super-héros adolescents qui n’avaient jamais eu droit jusque-là qu’à des rôles de faire-valoir difficilement glorieux. Marv et George ont résolument changé la donne, pour notre plus grand plaisir… Car il faut bien avouer que The New Teen Titans est une série vraiment très chouette, innovante et profonde, drôle et pleine de tension, remodelant complètement le concept de super-ados en leur donnant une indépendance et une responsabilité qui n’ont rien à envier à celles de leurs aînés. Et puis il faut dire que des personnalités telles que Raven et Starfire – assez diamétralement opposées – sont tout de même un atout formidable pour cette équipe, alliant le mystère le plus profond à l’ingénuité la plus débridée. Raven est sans aucun doute le personnage le plus dense de cette série ; ceux qui connaissent l’ensemble de l’œuvre savent de quoi je parle, les autres découvriront bien assez tôt que cette jeune femme plongera l’équipe et le monde dans des abîmes insensés…
Au sommaire de ce deuxième volume où la série commence à prendre de l’épaisseur, des aventures plus ou moins courtes mais toujours dignes d’intérêt : le Terminator (non non, pas Schwarzie) et son projet Promethium de tous les dangers, le combat de nos jeunes Titans contre les ancestraux Titans mythologiques de l’Olympe (ce qui donne l’occasion à Pérez de dessiner de grands moments de bravoure graphique), et surtout le retour de la Confrérie du Mal qui va nous donner bien des suées, je vous le promets, avec dans l’ombre le fantôme de Doom Patrol… Plus quelques autres surprises dont de grands bonheurs et de grands drames, mais chut !
J’avoue avoir toujours adoré le trait de Pérez, précieux et harmonieux sans pour autant perdre de son énergie, et son sens du détail qu’on ne retrouve guère que chez de grands artistes comme Jim Starlin, Bob Layton, ou John Byrne lorsqu’il est encré par le génialissime Terry Austin. Et même si Pérez n’est jamais aussi bon que lorsqu’il s’encre lui-même, nous ne pourrons qu’admirer ses dessins qui s’amélioraient d’épisode en épisode à cette période, sous l’encrage néanmoins un peu trop simplificateur de Romeo Thangal. Mais ne soyons pas trop pinailleurs et goûtons notre plaisir, car The New Teen Titans, ce n’est que du bonheur, les ami(e)s.
EN KIOSQUE DEPUIS MARS
Compte tenu de ce que je vous ai dit en introduction à cette longue chronique (ça va, vous êtes encore là ?), vous comprendrez aisément que cette partie « kiosque » est un peu caduque et qu’il est vain que je m’excite à vous parler de publications qu’on ne trouve plus forcément chez les marchands de journaux… Mais bon… Au cas où vous en auriez l’opportunité, l’ensemble de ces titres est encore disponible dans les librairies spécialisées !
MAGAZINES
-COMIC BOX #45 et #46.
Dans ma dernière chronique je m’inquiétais de la santé de Comic Box, la seule vraie revue digne de ce nom consacrée au monde du comic-book. Eh bien comme un retour du destin, vous avez dû apprendre si vous la lisez régulièrement (ce que je vous recommande vivement) que Panini a repris le titre, ce qui devrait assurer à ce dernier une jolie pérennité. Du coup, la numérotation est revenue à celle de la première série, la deuxième étant devenue par la force des choses une parenthèse qui aura tout de même permis un changement de format plus qu’appréciable. Bravo les gars et bonne continuité !
DELCOURT COMICS
-LES CHRONIQUES DE SPAWN #11 (#12 dispo depuis le 09 mai).
Encore toutes nos félicitations à Delcourt pour sa pugnacité à faire découvrir en kiosque la continuité de la saga Spawn. Ce numéro reprend Spawn #159 et #160 par David Hine et Philip Tan, ainsi que Cy-Gor #5. À noter cette fois-ci une couverture tout simplement magnifique.
-ASPEN COMICS #13.
Les épisodes 5 et 6 de Fathom vol.2 vous attendent dans ce nouveau numéro disponible depuis début avril. Petite incartade temporelle dans cette section, je me devais de l’annoncer malgré tout (ahlalalala c’est pas facile tout ça). La belle Aspen n’attend que vous, que vous vous jetiez dans ses pages, chez vous ou à la nage… N’hésitez pas !
PANINI COMICS
Autant vous le dire tout de suite, la déferlante Civil War va épargner bien peu de titres Marvel ! Spider-Man et Wolverine dès mars, Marvel Icons et Astonishing X-Men dès avril, et le phénomène va continuer de s’étendre, je vous préviens ! Je ne parlerai ici que de la série titre, et reviendrai en détail sur les autres publications quand les choses seront rentrées dans l’ordre. Mais n’oubliez pas qu’Ultimate Fantastic Four #17 est en kiosque depuis avril !
-CIVIL WAR #1 (#2 dispo depuis avril, #3 depuis début mai).
Ça y est c’est parti ! Ça va débouler et tout chambarder ! À peine sortie du délirant et très perturbant House of M, Marvel remet le couvert avec une nouvelle mini-série (mais maxi-effets !) remettant en question tout son univers ! Décidément, la Maison des Idées n’a pas froid aux yeux en ce moment… Signe des temps, ou volonté forcenée d’entamer une nouvelle ère, en tout cas tout ça est terriblement excitant. Le concept de Civil War est un thème qui a déjà été abordé de nombreuses fois dans bien des séries Marvel, notamment dans Spider-Man et très récemment dans Daredevil, à savoir l’identité secrète des justiciers masqués (on peut même dire que cette idée est l’un des thèmes primordiaux dans les comics de super-héros). Mais ici le thème est poussé à son paroxysme, puisqu’une loi gouvernementale exige que les super-héros dévoilent tous leur véritable identité afin d’être au clair avec les autorités, pour que la justice ne soit plus rendue en partie par des inconnus pouvant mettre à mal la bienséance américaine. Rien que ça ! Dans les rangs de nos super-amis, certains vont se plier à l’injonction… et d’autres vont foncièrement refuser cet ordre qu’ils jugent inacceptable ou tout simplement ingérable pour la suite de leur existence. Cet état de fait va être le détonateur d’une véritable guerre fratricide où les super-héros vont se battre les uns contre les autres avec violence et détermination. Mais jusqu’où tout ça va aller ?!? Je n’en dirai pas plus aujourd’hui, et reviendrai bien évidemment sur cette passionnante mini-série en sept volets qui n’a pas fini de faire couler… de l’encre. C’est l’excellent Mark Millar qui en signe le scénario et nous retrouvons Steve McNiven au dessin.
Cecil McKinley.